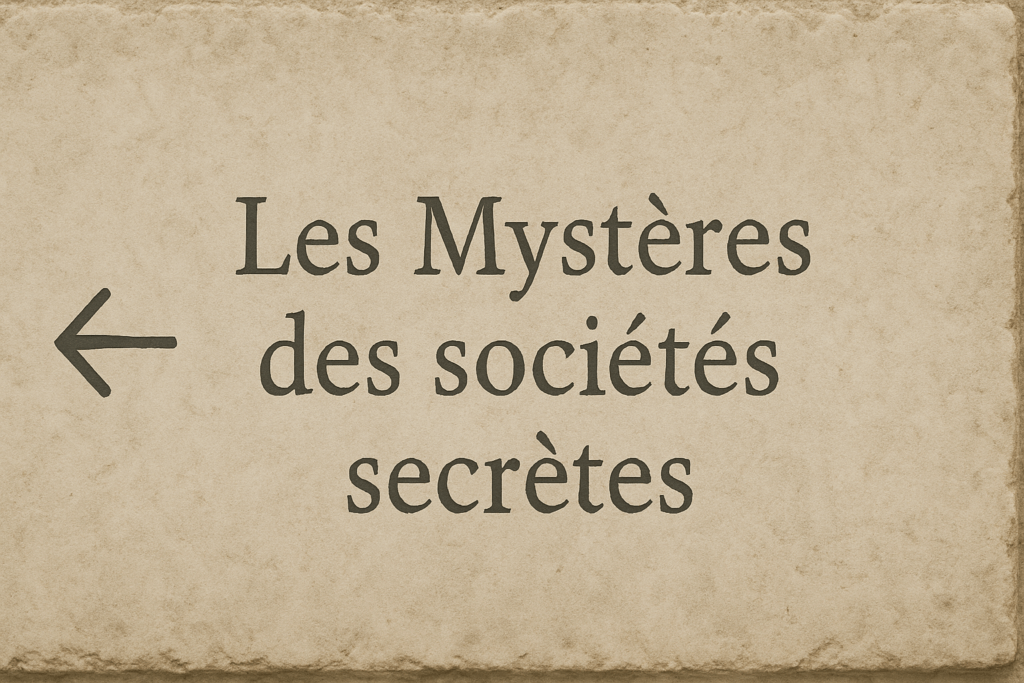Le Néo-Templarisme
Depuis plus de sept siècles, l’ombre des Templiers plane sur l’imaginaire collectif.
Né dans la ferveur des croisades, l’Ordre du Temple, fondé au début du XIIᵉ siècle par Hugues de Payns, fut bien plus qu’une simple confrérie de moines-soldats. Il constitua une véritable puissance économique, politique et spirituelle, une armée du Christ aux méthodes d’une modernité stupéfiante pour son temps. Mais son éclat fut aussi sa perte : accusés d’hérésie et d’idolâtrie par le roi Philippe le Bel, les Templiers furent arrêtés un sinistre vendredi 13 octobre 1307. Leur Grand Maître, Jacques de Molay, finit sur le bûcher, et leur ordre fut officiellement dissous par le pape Clément V.

Pourtant, si les Templiers disparurent dans les flammes de l’Inquisition, leur légende, elle, ne fit que grandir. Au fil des siècles, l’idée d’un héritage caché – spirituel, ésotérique, ou même matériel – traversa le temps, se transformant en mythe fondateur d’innombrables sociétés initiatiques. Et parmi celles-ci, la franc-maçonnerie allait devenir le plus puissant réceptacle de ce rêve d’immortalité templière.
Le chevalier de Ramsay : l’inventeur du mythe templier moderne
C’est dans la France du XVIIIᵉ siècle que le mythe du Templier renaît de ses cendres.
Son architecte en fut un homme : Andrew Michael Ramsay, plus connu sous le nom de chevalier de Ramsay (1693-1743). Écossais d’origine, écrivain et philosophe cosmopolite, Ramsay s’imposa comme l’un des plus grands orateurs de la franc-maçonnerie française. Son fameux discours de 1736, prononcé devant la loge parisienne de Saint-Jean d’Écosse, constitue un véritable tournant : il y forge une filiation imaginaire entre les chevaliers croisés et les francs-maçons.
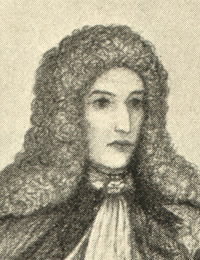
Selon Ramsay, les croisés – et plus particulièrement les Templiers – auraient formé, en Terre Sainte, une confrérie spirituelle détentrice des antiques sagesses venues d’Orient.
Les maçons, héritiers de cette chevalerie sacrée, n’auraient fait que perpétuer leurs traditions et leurs symboles sous des formes nouvelles. Cette thèse, aussi séduisante qu’infondée historiquement, allait enflammer l’Europe maçonnique.
L’intégration des Templiers dans la franc-maçonnerie
Entre 1750 et 1760, l’imaginaire templier s’enracine profondément dans les loges.
Apparaissent alors les grades templiers, notamment dans les loges françaises et germaniques. Des récits légendaires prétendent que les grands maîtres du Temple avaient conservé un savoir secret, transmis de siècle en siècle jusqu’aux francs-maçons modernes.
Ces mythes atteignent parfois le merveilleux : on raconte que, la veille de son exécution, Jacques de Molay aurait confié à son neveu, le comte de Beaujeu, les mystères de l’Ordre. Dans la crypte du Temple de Paris, celui-ci aurait découvert un écrin contenant le doigt de Jean-Baptiste, la couronne du royaume de Jérusalem, le chandelier à sept branches, les quatre évangélistes d’or du Saint-Sépulcre, et un trésor caché dans deux colonnes creuses – étrangement semblables à celles des temples maçonniques !

Ces récits, entre allégorie et fable, ancrent définitivement les Templiers dans l’arbre symbolique de la maçonnerie. Le Templier devient dès lors une figure de transmission, de pureté et de résistance spirituelle.
Fabré-Palaprat : le fondateur du néo-templarisme
Un siècle plus tard, un homme va donner corps à ces légendes :
Bernard-Raymond Fabré-Palaprat (1773-1838), médecin, mystique et créateur d’un Ordre du Temple en 1804. Il affirme posséder un document extraordinaire : la Carta Transmissionis, prétendument datée de 1324, dans laquelle Jacques de Molay aurait désigné son successeur, Jean-Marc Larmenius, perpétuant ainsi la lignée templière à travers vingt-deux grands maîtres, jusqu’à Fabré-Palaprat lui-même. Parmi ces noms figureraient même Bertrand du Guesclin et d’autres figures historiques !

Le succès de Fabré-Palaprat est rapide. Soutenu un temps par Napoléon Bonaparte, il organise en 1808 à Paris de fastueuses processions, des cérémonies à Notre-Dame, où flottent des bannières ornées de croix pattées. Entouré de dignitaires aux titres grandiloquents, il rêve de prieurés en Orient, au Japon ou en Afrique. En 1828, il fonde même une Église johannite, en rupture ouverte avec Rome, affirmant renouer avec le christianisme primitif de saint Jean.
Mais la mort de Fabré-Palaprat en 1838 met un terme à ce templarisme d’Empire. Les divisions internes, entre une faction « catholique » et une autre « laïque », achèvent de désagréger le mouvement.
La lente résurgence du XIXᵉ siècle
Pourtant, le rêve templier ne s’éteint jamais tout à fait.
En 1894, la branche belge encore active fonde à Bruxelles le Secrétariat international des Templiers, avant de se reconstituer en 1932 sous le nom de Grand Prieuré de Belgique. Ce dernier donne naissance à l’Ordre Souverain Militaire du Temple de Jérusalem (O.S.M.T.J.), qui deviendra l’une des organisations néo-templières les plus durables et respectées.

L’après-guerre : le renouveau spirituel
Après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe aspire à la reconstruction — matérielle, mais aussi spirituelle. Les ruines appellent la foi, le doute appelle le sens.
C’est dans cette atmosphère de quête intérieure que le mythe templier connaît une résurgence spectaculaire.
Un homme va en devenir la figure emblématique : Jacques Breyer (1922-1996).
En 1952, il apprend l’existence d’un trésor templier dissimulé dans le château d’Arginy, demeure ancestrale de la famille de Beaujeu – la même lignée dont était issu Guillaume de Beaujeu, Grand Maître du Temple au XIIIᵉ siècle.

Breyer, mystique et érudit, se rend au château et y rencontre le comte de Rosemont, propriétaire des lieux. Une étrange affinité les unit. Breyer s’installe à Arginy, où il demeure sept années, consacrées à des recherches occultes et spirituelles dans la tour du château. Là, selon la légende, il aurait reçu en rêve l’injonction de réveiller l’esprit du Temple.
Arginy : la résurgence néo-templière
Autour de Breyer gravitent des personnalités singulières :
le médium Marcel Vayre de Bagot, l’alchimiste Armand Barbault (auteur du célèbre L’Or du Millième Matin), et d’autres initiés. Le 12 juin 1952, à 22 heures, une expérience théurgique majeure aurait eu lieu à Arginy, marquant la renaissance de l’Ordre Souverain du Temple Solaire (O.S.T.S.) — que ses adeptes appelleront plus tard la Résurgence d’Arginy.
Breyer rencontre ensuite Maxime de Roquemaure, héritier d’une lignée catalane de templiers et grand maître adjoint d’un groupe parallèle. Ensemble, ils structurent un réseau de commanderies. En 1956, plusieurs membres influents de la Grande Loge Nationale Française (GLNF), dont Vincent Planque et Pierre de Ribaucourt, les rejoignent. Une première commanderie est fondée dans le Dévoluy, entre Gap et Grenoble. Même Mgr Jean de Saint-Denis, évêque de l’Église orthodoxe de France, y est reçu.

Mais en 1964, Breyer se retire. L’année suivante, un certain Julien Origas rejoint l’Ordre.
Le 24 juin 1966, l’O.S.T.S. se révèle au grand jour avec l’élection de Jean Soucasse comme 23ᵉ Grand Maître. L’Ordre est reconnu officiellement à Monaco en 1967.
Jacques Breyer meurt en 1996, laissant derrière lui un héritage indéniable : celui du père du néo-templarisme moderne.
Des lumières aux ombres : la dérive de l’Ordre du Temple Solaire
Mais l’histoire du néo-templarisme moderne ne s’arrête pas là.
Dans les décennies suivantes, des dérives tragiques surgiront. Certaines organisations se réclameront de l’héritage spirituel du Temple pour glisser vers le fanatisme ésotérique — la plus sinistre étant l’Ordre du Temple Solaire (O.T.S.), tristement célèbre pour les drames survenus dans les années 1990 en Suisse et au Canada.
L’héritage contemporain : le retour à la lumière
Malgré ces déviances, une filiation plus sérieuse et structurée perdure aujourd’hui.
L’O.S.M.T.H. (Ordre Souverain Militaire du Temple de Jérusalem), fondé en 1995 et enregistré en 1999 en Suisse, se veut l’héritier spirituel et humaniste des Templiers. En 2002, il obtient la reconnaissance de l’ONU en tant qu’ONG, œuvrant pour la paix, la tolérance et la coopération entre les peuples.
Ainsi, le mythe du Temple, loin d’être éteint, continue d’irriguer les consciences.
De l’ordre médiéval à la franc-maçonnerie, des mystiques d’Arginy aux loges modernes, le templarisme demeure un pont entre l’Histoire et l’Esprit — entre la quête du savoir et celle du sacré.
Un souffle venu du Moyen Âge, mais qui, aujourd’hui encore, murmure à l’oreille de ceux qui cherchent la lumière dans le silence des symboles.