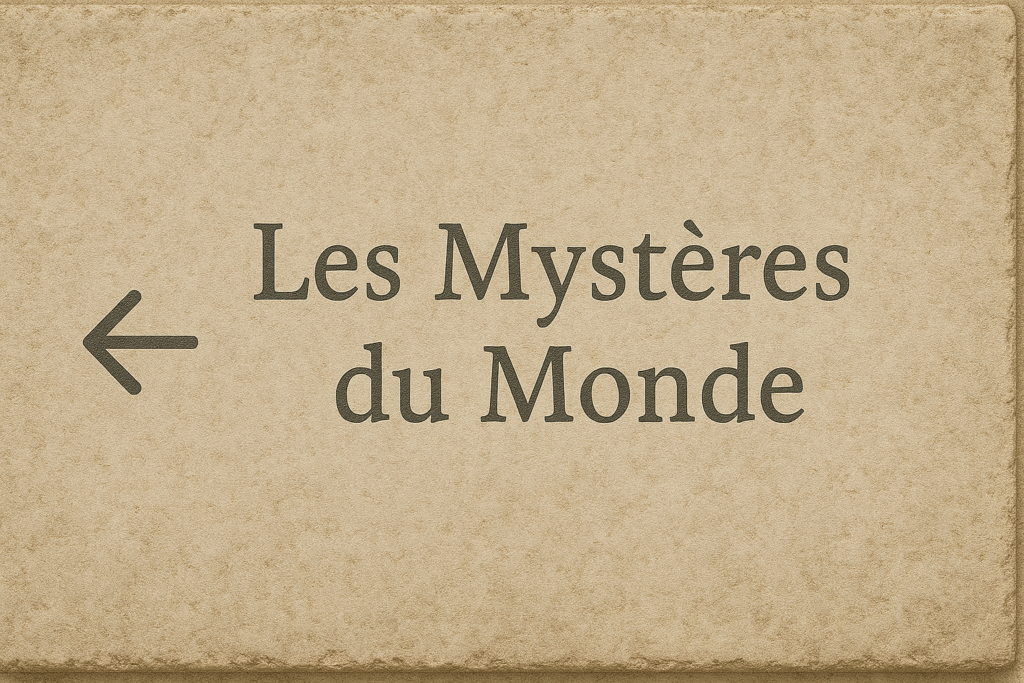Le culte de Mithra
« Si le christianisme eût été arrêté dans sa croissance par quelque maladie mortelle, le monde eût été mithraïste. »
Cette célèbre réflexion de l’historien et archéologue Robert Turcan — membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, spécialiste incontesté de l’Antiquité romaine — résume à elle seule la proximité troublante entre deux religions nées presque simultanément : le christianisme et le culte de Mithra.

Les origines d’un culte solaire
Le mithraïsme, ou culte de Mithra, plonge ses racines dans l’ancien monde iranien. Introduit dans l’Empire romain à la fin du Ier siècle, il s’y répandit rapidement, notamment parmi les soldats. À cette époque, alors que le christianisme commençait à se diffuser discrètement en Orient, le culte de Mithra trouvait un terrain fertile dans les légions romaines, les ports et les provinces frontalières de l’Empire.

Cependant, le culte romain de Mithra se distingue profondément de ses origines perses. Il devient, à Rome, une religion à mystères, à caractère initiatique et ésotérique. Sa transmission se faisait non par l’écrit, mais par la parole et le rituel. Les adeptes, exclusivement masculins, se réunissaient dans des sanctuaires souterrains, les mithraea, reproduisant symboliquement la grotte où, selon la légende, Mithra sacrifia un taureau primordial.

Un culte réservé aux initiés
Les communautés mithriaques étaient structurées en plusieurs degrés hiérarchiques, du simple fidèle jusqu’au Pater, le « Père » qui dirigeait les cérémonies. Les rites, ponctués de repas sacrés et de banquets communautaires, célébraient la victoire de Mithra sur le taureau, acte fondateur qui régénérait la nature et assurait le salut du monde. Le mithraïsme se voulait donc une religion du renouveau et du salut, centrée sur le sacrifice, la lumière et la victoire sur les ténèbres.

Les parallèles troublants avec le christianisme
L’apparition du christianisme et celle du mithraïsme au sein du même Empire, à la même période, ne pouvaient qu’éveiller les comparaisons. Les Pères de l’Église eux-mêmes en furent conscients. Tertullien, au IIᵉ siècle, qualifia le culte de Mithra de « contrefaçon diabolique » du christianisme, tant les ressemblances semblaient nombreuses :
- Tous deux reposent sur un sacrifice fondateur — le Christ crucifié pour le salut des hommes, Mithra immolant le taureau cosmique pour régénérer la vie.
- Tous deux proposent un rite de communion autour d’un repas symbolique.
- Tous deux promettent un salut individuel et collectif après la mort.
Le symbolisme solaire de Mithra — dieu invaincu, vainqueur des ténèbres — fait également écho à la lumière du Christ ressuscité. L’un et l’autre connaissent une ascension céleste : Mithra s’élève sur son char solaire ; le Christ monte aux cieux.
Certaines coïncidences calendaires renforcent encore ce parallèle :
le 25 décembre, date de la naissance de Mithra célébrée sous Aurélien comme Dies Natalis Solis Invicti, deviendra plus tard celle de la Nativité du Christ. De même, le dimanche, jour du Soleil, sera consacré au culte du Ressuscité.
Deux voies spirituelles, deux destins opposés
Pourquoi alors le christianisme triompha-t-il là où le culte de Mithra s’éteignit ?
Les raisons tiennent autant à la nature même de ces religions qu’au contexte politique.
Le mithraïsme était secret, fermé et masculin : seuls les initiés pouvaient y accéder. Il ne se diffusait qu’au sein de cercles restreints — soldats, fonctionnaires ou commerçants.
Le christianisme, au contraire, se voulut ouvert et universel. Accessible aux hommes comme aux femmes, prônant une foi publique et un enseignement partagé, il s’adressa à toutes les classes sociales. Là où Mithra réservait la connaissance à quelques initiés, le Christ parlait aux foules.
Les enjeux politiques de la foi Au tournant du IVᵉ siècle, les chrétiens deviennent un groupe influent. Leur présence dans les villes et les campagnes romaines pèse sur la vie politique et sociale. Face à eux, les adorateurs de Mithra et autres païens apparaissent comme les défenseurs d’un monde ancien, bientôt condamné.
L’empereur Constantin Ier, conscient de cette évolution, joue un rôle décisif.
En 312, avant la bataille du Pont Milvius, il aurait vu dans le ciel un signe : un chrisme flamboyant accompagné des mots : « Par ce signe tu vaincras ». Convaincu d’avoir reçu l’appui du Dieu chrétien, il fait peindre le symbole sur les boucliers de ses soldats et remporte la victoire.

Un an plus tard, il signe avec Licinius l’Édit de Milan (313), garantissant la liberté de culte à tous les citoyens et restituant aux chrétiens les biens confisqués lors des persécutions.
Le crépuscule des dieux anciens
Ce tournant marque le début du déclin du mithraïsme.
Les soldats, autrefois dévoués à Mithra, embrassent la foi chrétienne par fidélité à l’empereur. Le culte secret, déjà fragilisé, s’éteint peu à peu, faute d’adeptes.
En 325, Constantin convoque le Concile de Nicée, réunissant les évêques de tout l’Empire pour unifier la doctrine chrétienne. Douze ans plus tard, sur son lit de mort, il reçoit le baptême. Devenu le premier empereur chrétien, il consacre la victoire définitive du christianisme.

Ce geste, à la fois spirituel et politique, sonne le glas des religions païennes.
Le culte de Mithra, jadis florissant dans les souterrains des cités romaines, disparaît dans les ombres de l’Histoire.
Mais de ce culte solaire subsiste une empreinte lumineuse, un reflet antique dans les symboles mêmes de la foi chrétienne : la lumière triomphante, la communion sacrée, la promesse du salut.